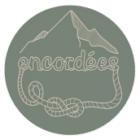Enquête : la rémunération des athlètes féminines
Aucune femme n’apparaît dans le top 100 des athlètes les mieux rémunérés. Une phrase qui résonne comme une réalité frappante dans le monde du sport professionnel. Car malgré des évolutions notables sur le plan des mentalités et des politiques sportives, l’écart économique entre les athlètes masculins et féminins reste encore abyssal. Les raisons de cette inégalité sont multiples, allant des stéréotypes de genre profondément ancrés à la faible visibilité du sport féminin. Alors que des figures comme Serena Williams ou Naomi Osaka ont marqué l’histoire, le monde du sport professionnel continue de faire face à un plafond de verre pour ses athlètes féminines. Tant en termes de rémunération que de reconnaissance.

À temps de travail équivalent, le salaire moyen des femmes reste inférieur de 14,2 % à celui des hommes.
Les femmes occupent 42 % des postes salariés du secteur privé en équivalent temps plein, mais ne représentent que 24 % du top 1 % des emplois les mieux rémunérés.
À poste et établissement identiques, l’écart de salaire net en équivalent temps plein se réduit toutefois à 3,8 %.
(Source : INSEE)
Le monde du sport n’échappe pas à ce phénomène, qu’il s’agisse des salaires ou des primes. À titre d’exemple, l’équipe féminine de football des États-Unis, qui génère pourtant davantage de revenus que son homologue masculine, a déposé une plainte pour discrimination salariale contre la fédération américaine (U.S. Soccer) en 2016, affirmant percevoir 75 % de moins que les hommes.
Aucune femme dans le top 100 des athlètes les mieux payés en 2024
Depuis 1990, le magazine économique américain Forbes publie chaque année un classement des athlètes les mieux rémunérés. À ses débuts, la liste ne comptait que trente noms, et certaines femmes parvenaient à y figurer, notamment les grandes tenniswomen de l’époque comme Steffi Graf, Gabriela Sabatini, Monica Seles ou encore Jennifer Capriati.
« Les premiers classements faisaient la part belle aux sports individuels, avec seulement onze athlètes de sports collectifs en 1990 et neuf en 1991 », précise le magazine sur son site. En 2018, la tendance s’est inversée : « Les sportifs issus des disciplines collectives représentaient 82 % du classement. Les salaires dans ces sports ont explosé ces 25 dernières années, les médias dépensant des milliards de dollars pour acquérir les droits de diffusion en direct. Le plus haut salaire de la NBA en 1990 était de 3,75 millions de dollars pour Patrick Ewing. En 2018, Stephen Curry a empoché 34,7 millions de dollars avec les Golden State Warriors. »
L’année 2018 marque un tournant : pour la première fois, aucune femme ne figure dans le classement des athlètes les mieux payés. Devenu un top 50 en 2010, puis un top 100 en 2012, le classement Forbes reflète de plus en plus l’écart croissant entre les genres.
« L’absence de femmes dans ce classement s’explique par plusieurs facteurs », poursuit le magazine. « La tenniswoman chinoise Li Na a pris sa retraite en 2014, Maria Sharapova, classée onze années consécutives, subit encore les conséquences de sa suspension de 15 mois pour dopage, et Serena Williams n’a participé à aucun tournoi WTA depuis janvier 2017, date à laquelle elle a annoncé sa grossesse. Son total de gains s’est donc limité à 62 000 dollars cette année-là, contre 8 millions l’année précédente. »
Et en 2024, la tendance persiste : aucune athlète féminine ne figure dans le top 100. Avec des revenus estimés à 34,4 millions de dollars, la jeune star du tennis Coco Gauff, 20 ans, réalise toutefois l’une des meilleures performances financières pour une sportive. Elle reste néanmoins loin derrière ses consœurs Naomi Osaka et Serena Williams, qui avaient atteint respectivement 57,3 millions et 45,9 millions de dollars en 2022, la classant cette année à la 125e place.
Pour la première fois dans l’histoire des données de Forbes, chacun des dix athlètes les mieux payés en 2024 a gagné plus de 100 millions de dollars, dépassant ainsi le précédent sommet de huit athlètes en 2023. Du côté des femmes, les 20 athlètes les mieux rémunérées ont cumulé plus de 258 millions de dollars en 2024, marquant une augmentation de 15 % par rapport aux 226 millions de dollars enregistrés en 2023.
Cependant, le total combiné des revenus des sportives représente moins de 12 % des revenus des 20 sportifs les mieux payés au monde, qui ont généré un montant estimé à 2,23 milliards de dollars en 2024.

Le sport féminin continue toutefois d’être perçu comme moins « rentable »
De tels écarts renforcent le préjugé selon lequel « les hommes sont de meilleurs athlètes que les femmes » et qu’ils sont plus légitimement présents dans le sport. Cependant, la réalité est bien plus complexe. Prenons l’exemple de deux phénomènes du basketball, des joueurs d’exception qui n’émergent qu’une fois par génération : l’Américaine Caitlin Clark, sélectionnée par le Fever de l’Indiana, membre de la WNBA pour la saison à venir, et le Français Victor Wembanyama, choisi par les Spurs de San Antonio lors de la saison précédente en NBA.
« Leur talent transcende les limites du terrain ; leur attrait auprès du public et leur charisme personnel sont tout aussi impressionnants », note Forbes. « Il n’y a jamais eu de doute sur leur statut de premier choix, leur suprématie sur le terrain étant incontestable. » Pourtant, Caitlin Clark se heurte à des plafonds salariaux bien inférieurs à ceux de la NBA. « Cette disparité salariale est souvent attribuée à des facteurs comme l’audience, les revenus publicitaires et la popularité générale du sport féminin par rapport à celui des hommes. Toutefois, de nombreux défenseurs de l’égalité des sexes dans le sport affirment que ces différences sont injustifiées et appellent à des réformes pour garantir un salaire égal pour un travail égal, quel que soit le genre », poursuit Forbes.
Quand on examine de plus près, on constate que Victor Wembanyama a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 55 millions de dollars. De son côté, Caitlin Clark a reçu 338 056 dollars. Pas par an, mais pour ses quatre premières années au sein de la WNBA.
Il existe cependant des raisons d’espérer. Depuis 2007, Roland-Garros a instauré l’égalité des primes entre hommes et femmes. Cette politique est désormais appliquée dans de nombreux sports, tels que le biathlon, le surf ou encore les CrossFit Games. Actuellement, 35 fédérations suivent ce modèle et distribuent des dotations égales pour les hommes et les femmes.
Le sport féminin continue cependant d’être perçu comme moins « rentable », moins médiatisé, moins sponsorisé, moins suivi et donc moins rémunéré. Une boucle infernale, alimentée par des stéréotypes et une vision archaïque du sport. Cette inégalité trouve ses racines dans l’histoire. Pendant longtemps, certaines disciplines sportives ont été fermées aux femmes ou leur développement a été limité, ce qui a laissé des traces durables sur les structures et les investissements dans le sport féminin.

Aujourd’hui encore, 40 % des filles abandonnent le sport au début de l’adolescence, soit deux fois plus que les garçons. Les raisons sont multiples : un manque de confiance en soi (environ 6 filles sur 10 estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour continuer), des stéréotypes de genre (avec des idées reçues sur les « sports pour filles » ou les jugements sur les corps dits « trop musclés »), l’absence de modèles féminins (moins de 30 % des coachs et entraîneurs sont des femmes), ainsi que la pression des études et des obligations sociales. À l’âge de 17 ans, 51 % des filles déclarent être trop occupées par leurs études et leur vie sociale pour continuer à pratiquer une activité sportive.
De plus, les sports pratiqués par les femmes, moins médiatisés, génèrent moins d’opportunités de sponsoring, ce qui, selon les fédérations et sponsors, justifie les écarts de rémunération. Le manque de visibilité du sport féminin dans les médias empêche les marques de proposer des contrats de sponsoring aussi lucratifs que ceux offerts aux stars masculines telles que LeBron James, Cristiano Ronaldo ou Tom Brady (football américain). Même les sportives évoluant dans des disciplines dominées par les hommes, comme Ronda Rousey en MMA, ont peu de chances d’apparaître un jour dans les classements des athlètes les mieux rémunérés.
Ces disparités financières forment un véritable cercle vicieux qui freine la progression des sportives. Faute de rémunération suffisante, elles doivent jongler entre l’entraînement et un emploi classique. Or, une athlète qui s’entraîne moins voit ses performances stagner, ce qui conduit à une moindre visibilité médiatique et donc à des opportunités de sponsoring limitées, impactant ainsi sa rémunération.
Et les sports outdoor dans tout ça ?
Dans des disciplines comme l’escalade, l’alpinisme ou le trail, les chiffres restent flous. En d’autres termes, il est difficile de savoir exactement combien gagnent les athlètes. La plupart des compétitions proposent une rémunération égale, et bon nombre d’entre elles se déroulent en même temps que celles des hommes (en trail, par exemple) ou presque (sur la même journée ou le même week-end). Mais qu’en est-il des contrats de sponsoring ? Et des possibles disparités salariales entre hommes et femmes ? Le sujet reste largement ignoré. Alors, nous avons décidé de le soulever chez encordées. Affaire à suivre.